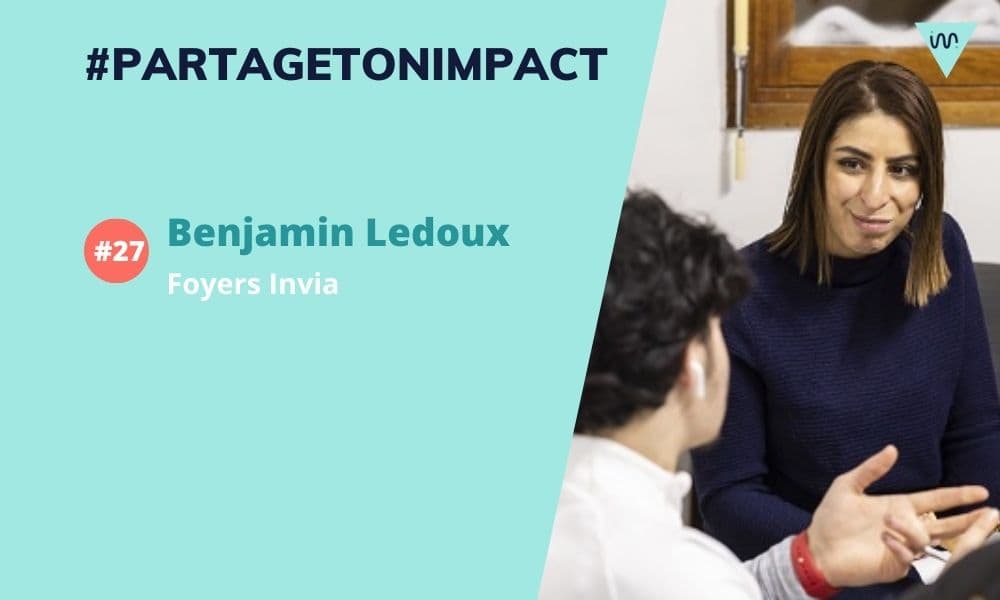Foyers Invia est l’une des 5 structures ayant fait partie de l’expérimentation menée par Nexem dans le cadre de l’appel à projets FSE+ pour une mesure d’impact collective dans le secteur de la Protection de l’enfance en France. Benjamin Ledoux, directeur de l’association, revient sur cette innovation dans les foyers éducatifs et les enjeux de valoriser l’impact du secteur.
Pouvez-vous nous présenter les Foyers Invia ?
Nous sommes une association parisienne de protection de l’enfance. Les Foyers Invia, c’est 2 établissements à Paris et plusieurs logements collectifs, une capacité totale de 110 places pour des jeunes âgés de 11 à 21 ans. Le parcours d’accompagnement s’organise autour de 7 services éducatifs comprenant chacun, en fonction des besoins, entre 5 et 9 éducateurs, moniteurs, ou animateurs, et un chef de service éducatif. Des fonctions médico-sociales, infirmière et psychologues viennent également en appui des équipes et des jeunes.
L’accueil en foyer intervient le plus souvent après une décision du juge des enfants qui confie au département le soin de protéger un enfant, du fait de difficultés importantes des parents, d'une carence éducative, ou d’une maltraitance. En quelques mots, l’accueil en foyer vise d’abord à garantir la sécurité, à prendre soin, puis à inscrire les jeunes dans un cadre de vie pour qu’ils puissent entrer dans la vie d’adulte suffisamment armé, avec une formation choisie et en voie de réussite, ainsi qu’une stabilité résidentielle et de ressources.
Les séjours des jeunes sur l’ensemble des services durent généralement entre 2 et 5 ans.
A noter que pour cette mesure d’impact, nous avons limité l’étude au public âgé entre 13 et 18 ans.
Vous avez fait partie d’une expérimentation pour une mesure d’impact social en protection de l’enfance, proposée par Nexem, dont vous êtes adhérents. Pourquoi mesurer l’impact des foyers éducatifs ?
Cette mesure permet d’identifier les progrès à réaliser, et de donner sens et perspectives à notre travail. C'est donc une source de motivation collective.
Par ailleurs, la recherche de bailleurs de fonds privés pour le financement de projets innovants est venue interroger notre capacité à rendre compte de nos actions, avec des grilles de lecture nouvelles qu’il faut pouvoir s’approprier.
C’est un fait, faute de données, nous nous contentons souvent de présenter notre action en nous limitant à quelques illustrations, quelques beaux récits qui sont tous bien réels, mais qui ne rendent pas compte objectivement et globalement des résultats recherchés.
Dans les foyers INVIA, nous nous contentions d’analyser la situation au départ des jeunes, uniquement sous le prisme de la situation résidentielle, de la formation et de l’emploi. Le plus souvent, les parcours les plus longs sont les plus réussis. Nous nous attachions donc aussi à contrôler la continuité des parcours et la durée des séjours.
Ces seuls indicateurs, actualisés chaque année, nous permettent de prendre du recul. Mais ce n’est pas suffisant pour apprécier l’ensemble du soutien que nous mettons à l’œuvre au quotidien pour les jeunes accueillis.
L'appel à candidature de Nexem correspondait donc parfaitement au besoin d'éclairage pour nos établissements, et de valorisation de nos pratiques. Mais je suis convaincu qu’il répond plus largement à une nécessité urgente pour la protection de l’enfance, qui doit mieux documenter l’impact de son action localement.
Je le constate, beaucoup de professionnels de notre secteur demeurent rétifs à ce type d’évaluation, parfois avec une vision caricaturale de cet exercice. C’est fort dommage.
Comment les Foyers Invia ont participé à l’expérimentation Nexem ?
Ce fut d’abord un échange de pratiques entre professionnels de différents foyers, mettant en évidence ce sur quoi l’attention était davantage portée par chacun dans notre quotidien. Selon la thématique, nous ne partagions manifestement pas toujours la même vision de notre responsabilité sur le résultat attendu et sur la façon même de l’apprécier. Nous avons pu confronter nos pratiques. En cela, c’était déjà très enrichissant.
Dans un premier temps, la démarche a abouti à la construction d’indicateurs fiables et simples à collecter. Cela reste pour autant une approche totalement innovante, apportant un regard sur le vécu des jeunes que nous n’avions jamais pu analyser de façon globale. C’est le paradoxe de cet exercice, qui une fois le cadre posé, demande peu d’investissement au regard des enseignements qu’il apporte.
On mesure ce que pourrait apporter à la protection de l’enfance davantage de volonté dans l’élaboration d’indicateurs de suivi du public. Personnellement, je regrette de ne pas avoir un secteur plus dynamique sur cet enjeu, et je me sens parfois culturellement en décalage.
Dans quel sens ?
Lorsque que je présente la démarche de mesure d’impact à d’autres cadres et dirigeants du secteur, les critiques fusent : “ ça fait enquête de satisfaction clientèle “, “l'approche est biaisée “, “c’est un outil de gestionnaire”, etc.
Mais qu’avons-nous d’autre à proposer pour sortir des anecdotes et des belles histoires ? Et comment reprocher à la démarche de venir interroger la satisfaction des jeunes ?
Du reste, c’est un mauvais procès. La méthode d’évaluation connait naturellement ses limites. Nous avons été guidés par des professionnels d’Impact Track, afin de réduire les biais et ne pas surinterpréter des résultats. C’est une démarche sérieuse !
Notre secteur est critiqué de toute part, sans nuance, sans distinction de territoire et de dispositif, quand certains “influenceurs” de la protection de l’enfance n’hésitent pas à manipuler des chiffres sans vérification, avec des interprétations parfois hâtives, ou erronées, et revenant à “jeter le bébé avec l’eau du bain”.
Nous en sommes en partie responsables, car nos collectifs et fédérations ne produisent aucune évaluation qualitative, aucun standard quantitatif...
C’est pourtant une urgence absolue : il faut saisir toutes les opportunités existantes pour valoriser ce qui est bien fait, et mieux cibler là où des progrès sont à réaliser. Il faut gagner en crédibilité pour obtenir des moyens supplémentaires.
Comment vous êtes-vous organisés autour de ce projet ?
D’abord, il fallait que je partage ma conviction du bien-fondé de cette approche auprès des équipes, puis que je m’entoure des personnes ayant vécu le quotidien, dans les foyers. C’est le cas avec mon adjoint qui, contrairement à moi, a été éducateur et chef de service.
Ensuite sur la réalisation et la collecte de données, il fallait trouver une méthode qui garantisse un bon taux de réponses, et qui soit la moins biaisée possible. Si la collecte est assurée par un éducateur, le jeune peut ressentir un conflit de loyauté, ou au contraire instrumentaliser l’étude pour régler ses comptes... J’ai donc préféré m’appuyer sur les assistants et assistantes de foyers qui disposent d’une position neutre, sans enjeux affectif avec les jeunes, pour expliquer la démarche et le cadre éthique.
Cette méthode semble avoir été la bonne, car d’autres associations ont préféré envoyer le questionnaire directement par SMS aux bénéficiaires, mais leur taux de réponses a été décevant.
Plusieurs éléments nous permettent d’affirmer que nos résultats sont robustes : le temps passé par chaque jeune sur les questionnaires, la cohérence avec certaines données de contrôle, les verbatims collectés à la fin des questionnaires qui étaient facultatifs mais dont le contenu est très riche.
Quels enseignements tirez-vous de cette mesure d’impact ?
Tout d’abord, j’ai été rassuré, car dans une écrasante majorité, les jeunes indiquent se sentir en sécurité et attribuent cela à la présence et l’action de l’équipe éducative. Ce n’est pas rien, car le mot « foyer » charrie tant de représentations négatives ! Ainsi, nous couvrons le premier méta-besoin du jeune.
Pour autant, il faut être vigilant aux signaux faibles qui se cachent derrière une statistique globale. Par exemple, les 5% de jeunes qui nous indiquent se sentir en insécurité sont exclusivement des filles. C'est l’expression de la “violence de genre”, et nous devons travailler cette question.
D’autres points ont attiré notre attention. Par exemple, le sentiment de solitude est plus important que ce que nous aurions projeté, car un foyer est par essence un collectif. Ce sentiment est-il plus important dans nos foyers que pour la population adolescente en générale ? Nous l’ignorons. Cependant, il y a un potentiel d’amélioration, car à bien y réfléchir, nous travaillons peu le maintien des réseaux amicaux existant avant le placement.
Ce fut aussi l’occasion de mesurer des échecs, par exemple sur la question des écrans, qui n’est pas perçu comme un enjeu de santé. Mon hypothèse, c’est que ce sujet est abordé à travers le risque de harcèlement, et non sur l’enjeu de santé mentale que pose la consultation outrancière des réseaux sociaux de certains adolescents. Sur ce point, les maisons d'enfants à caractère social ont les moyens de faire mieux, grâce à une présence éducative permanente. Encore faut-il que les adultes qui entourent les jeunes soient convaincus et davantage exemplaires...
Quels sont vos prochains défis ?
D'abord, il nous faut étudier et mettre en œuvre les mesures d’amélioration identifiées.
Ensuite, nous souhaiterions élargir la tranche d’âge interrogée aux jeunes majeurs et/ou aux sortants. Nous souhaiterions aussi renouveler chaque année cette évaluation pour construire un suivi de cohorte.
Enfin, notre association envisage d’ouvrir une nouvelle maison pour des jeunes enfants à Paris. Bien évidemment, nous allons utiliser l’évaluation en impact social pour mettre en valeur ce que nous savons faire, afin d’attirer des soutiens privés dans le financement de ce projet.
Avez-vous un conseil pour les porteurs de projet qui hésitent à se lancer dans une démarche de mesure d’impact ?
Je leur dirais : N’ayez pas peur ! Au mieux vous allez valoriser ce qui est fait, au pire vous allez en tirer des enseignements. Et quel que soit le résultat, cet exercice dynamisera les échanges avec les jeunes sur leurs conditions d’accueil.
C'est une approche bien moins fastidieuse que l’évaluation externe prévue par la Haute Autorité de Santé, et tout à fait complémentaire. C’est même une façon de documenter l’attention portée par l’établissement sur la bientraitance et la parole donnée aux jeunes qui nous sont confiés.
Pour aller plus loin
Découvrez les résultats complets de l’évaluation d’impact des Foyers Invia
Pour comprendre en quoi consiste la mesure d’impact sectorielle dans laquelle s’inscrit la démarche des Foyers Invia
👉 lisez notre article qui explique la méthodologie et les bénéfices
👉 découvrez l’article de Nexem consacré à cette démarche dans la Protection de l’enfance
Et partagez notre article sur Linkedin 😉